L’Orangerie, l’incontournable de l’été

« J’aime bien jouer les travers de l’humanité »
A Genève, au cœur du Parc La Grange, un théâtre ouvre ses portes au moment où les autres les ferment. A la tête de l’Orangerie qui bat son plein du 23 juin au 3 octobre, le comédien et metteur en scène Valentin Rossier nous parle « métier ». Son théâtre d’été est un havre de création artistique très prisé. C’est aussi un lieu festif incontournable, où il fait bon siroter un verre en musique. Avant-goût.
Le directeur et homme de théâtre que vous êtes sait aussi cultiver l’art de la fête. Cette année particulièrement ?
Quand on fait l’effort de venir à l’Orangerie, au cœur du parc La Grange qui est l’un des plus beaux parcs de Genève, on a forcément envie d’y rester. Il fallait donc nous mettre à jouer aussi le rôle de cafetier. C’est chose faite avec Le Bistrot, où l’on peut dîner et boire un verre en musique. La musique, c’est elle notre vraie partenaire cet été après la carte blanche donnée à la danse et à Foofwa d’Imobilité l’an passé. A toutes les premières de nos huit pièces, et tous les vendredis soir vers 22h00, on démarrera notre scène Jazz en terrasse en partenariat avec l’AMR1.
Trois ans déjà que vous dirigez le lieu, et votre mandat est reconduit pour trois nouvelles saisons… Dans quel état d’esprit êtes-vous ?
Je repars plutôt serein. A chaque année ses envies et ses soucis… Il s’agit aujourd’hui d’entamer à long terme des partenariats et des coproductions avec d’autres pays, entres autres la Belgique. Durant ces trois années d’apprentissage, j’ai pu constater un fort désir de théâtre, de narration et de jeu de l’acteur parmi le public. Ce qui n’exclut pas de revisiter les propositions théâtrales par des formes nouvelles. J’ai aussi envie de proposer de plus en plus de coproductions aux compagnies locales pour encourager les créations.
Mais cette envie, ne l’aviez-vous pas dès le début ?
Au départ, on proposait quatre accueils et seulement trois créations. Nous avons pu en financer une supplémentaire grâce à l’expansion de notre public et de nos recettes de billetterie.
Pourquoi ce désir de privilégier la création romande ?
C’est à mon sens un devoir, qui se fait d’autant plus ressentir aujourd’hui à Genève. Nombre d’artistes estiment qu’il y a un cloisonnement, une fermeture, et que certaines institutions ne font hélas pratiquement pas travailler les artistes locaux. Je trouve bien sûr important de stimuler les échanges, mais également essentiel de favoriser les productions locales : nous avons la chance d’avoir un théâtre romand d’une très grande richesse, qualité et diversité. C’est le rôle d’un directeur de théâtre que de le promouvoir et de le faire rayonner.
Dans votre petit théâtre de 120 places où l’on joue 99 fois en trois mois, le cinéma avec Un Tramway nommé Désir et l’adaptation de To be or not to be donne une note particulière à cette saison…
Les saisons de l’Orangerie sont cohérentes dans le sens où elles traduisent l’amour des textes et du théâtre. C’est cela qui fait le lien. Un Tramway nommé Désir est d’abord une pièce de théâtre avant d’être un film. Le but n’est pas de raconter une histoire, que tout le monde connaît, mais d’en faire un matériau qui parle de la nature humaine. La théâtralité amène une distance que le cinéma, en tout cas celui des années 1950, n’avait pas. Ce qui est intéressant, c’est de sublimer l’histoire d’une manière ou d’une autre.

Cette année, le metteur en scène n’a-t-il pas cédé du terrain au comédien ? On vous verra dans deux pièces, dont ce Tramway nommé Désir…
Oui, on peut dire cela comme ça… Mais pour moi, c’est en quelque sorte la même chose. Un comédien est un peu un metteur en scène, un metteur en scène un peu un comédien. Et le directeur de théâtre est un comédien-metteur en scène qui s’adapte… Dans un souci de parité, comme je mettrai une pièce en scène au Grütli en 2016, j’ai choisi de ne pas en monter cette saison à l’Orangerie. Il y aura juste la reprise de La Seconde surprise de l’amour, que j’ai créé ici l’an passé et où je joue effectivement. Je suis toujours comédien dans l’âme. Tout ce qui se passe autour est fonction de cela. Le jeu n’est pas une vocation, c’est un besoin. Ce qui voudrait peut-être dire la même chose…
Parlez-nous de vos rôles. Qu’y a-t-il de commun entre le Stanley Kowalski de Tennessee Williams et le chevalier pétri d’orgueil de Marivaux ?
Le lien, c’est Marie Druc, ma partenaire dans les deux pièces. Nous avions joué ensemble dans Qui a peur de Virginia Woolf ? Cet effet caméléon qui se produit chez elle et chez moi est très étonnant. On n’a jamais l’impression de retrouver les personnages qu’on a interprétés avant. Nous redémarrons à chaque rôle comme si c’était neuf. Elle et moi sommes des interprètes qui avons besoin d’un texte pour exister. Dans les deux cas, ce sont de grandes pièces, ce qui nous aide. Il suffit de se laisser embarquer par ces personnages.

Mais comment passe-t-on de l’un à l’autre à quelques siècles d’écart ?
On est dans des situations de jeu, ça se répond. Nous n’avons pas le temps de penser. On parle de théâtre psychologique mais il n’y a aucune psychologie chez Tennessee Williams. Tout est rythmique. Dans Marivaux, il s’agit plutôt d’un choc des langages. Le chevalier et la veuve sont meurtris, ils passent de l’amitié à l’amour sans pouvoir se l’avouer. Alors qu’entre Stanley et Blanche, il existe un rapport sensuel direct, une attraction et en même temps une différence. L’un et l’autre sont à l’opposé, un peu comme la belle et la bête. Stanley ne supporte pas le mensonge. Blanche, elle, se construit dans un autre monde, donc forcément ça ne marche pas…
De quel rôle vous sentez-vous finalement le plus proche ?
Je me sens malheureusement plus proche de Stanley que du chevalier romantique (rires). Il est totalement macho. Je me fais un peu son avocat même si je conscientise sa bêtise, sa fermeture. C’est quelqu’un de très instinctif, mais conformiste.
Mais qu’est-ce qui vous plaît donc tant chez lui ?
En somme, j’aime bien jouer les travers de l’humanité. Le théâtre a besoin de perversion, de souffrances, de sadisme. C’est une nécessité. Au même titre qu’il faut toujours des méchants dans les contes pour enfants, sinon il n’y aurait pas de contes…
Propos recueillis par Cécile Dalla Torre
[1] Association genevoise pour l’encouragement de la Musique impRovisée.
Théâtre de l’Orangerie, Parc La Grange à Genève. A découvrir notamment du 23 juin au 03 octobre 2015 :
> Un tramway nommé Désir / Tennessee Williams, mise en scève Zoé Reverdin
> La maladie de la famille M. / Fausto Paravidino, mise en scève Andrea Novicov
> To be or not to be / D’après Shakesspeare, mise en scène Eric Devanthéry
> Oblomov / Ivan Gontcharov, mise en scène Dorian Rossel
Découvrez toute la saison sur le site du théâtre www.theatreorangerie.ch
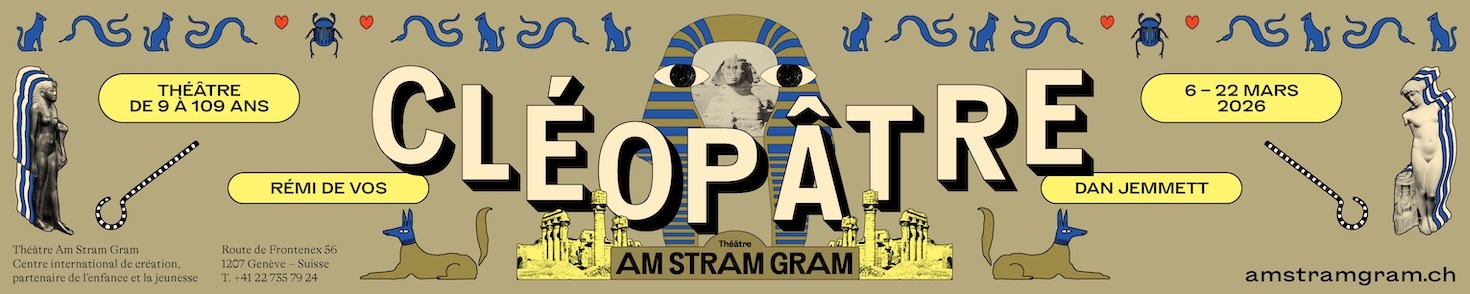




.gif)


