Un "Tramway" entre désir et répulsion

« On ne sait jamais qui de Blanche ou de Stanley est le personnage le plus fou… »
Le désir, le dégoût, la répulsion. Tennessee Williams a palpé ces sentiments comme nul autre et les a restitués dans une langue parlée éblouissante. Du 23 juin au 11 juillet, son mythique Tramway nommé Désir ouvre la saison de l’Orangerie à Genève. La metteure en scène Zoé Reverdin y scrute les corps à la loupe dans la moiteur de la Nouvelle-Orléans. Valentin Rossier joue Stanley Kowalski, incarné sur les planches et à l’écran par l’inoubliable Marlon Brando. Marie Druc est Blanche Dubois, l’un des plus beaux rôles féminins du théâtre américain. Dans les coulisses entre deux répétitions, Zoé Reverdin nous dit sa fascination pour l’œuvre de l’Américain.
D’où venez-vous Zoé Reverdin ?
Mon parcours de danseuse a démarré très tôt, j’ai côtoyé de grandes compagnies. Puis l’envie de raconter avec le mouvement a été plus forte que celle de danser moi-même. J’ai alors souhaité me rapprocher du théâtre. Un Tramway nommé Désir permet cette rencontre entre le langage du corps et de l’espace, et celui du sens du texte et du théâtre. Une rencontre qui n’aurait pas été possible sans l’homme de théâtre qu’est Valentin Rossier.
Qu’est-ce que l’œil de la chorégraphe apporte à la metteure en scène ?
La chorégraphe entend la musicalité de la prose, cerne la position des corps, la justesse du geste. On travaille sur ce qui n’est pas ostensible mais qui donne une vraie incarnation aux personnages. Ce qui prime, c’est sans doute ce regard à la loupe que je porte sur le corps humain au quotidien.
Le choix d’un dramaturge américain n’est pas anodin dans votre parcours de vie, où vous dites avoir beaucoup traversé les frontières ?
Les Etats-Unis seraient en quelque sorte ma patrie de prédilection. J’y ai vécu plus de neuf ans à différents moments de ma vie, et ce, dès l’enfance. Offrir une compréhension profonde de la culture américaine m’est cher. Traduire la force d’un Jim Morrison, la sensibilité d’un Tennessee Williams… L’immensité du territoire permet de devenir soi-même, de sortir des carcans sociaux aussi. Les individus dévorent leur relation jusqu’à la dernière miette. Je l’ai beaucoup ressenti là-bas. C’est ce que vivent les protagonistes de la pièce, un désir et une répulsion très instinctifs.
Pourquoi cette pièce de Tennessee Williams vous tenait-elle tant à cœur ?
J’avais « rencontré » cette œuvre là-bas comme on approfondit une matière. J’y avais aussi étudié le théâtre américain contemporain, qui est né à cette époque avec Arthur Miller, John Steinbeck, Scott Fitzgerald, etc. Beaucoup de ces auteurs ont voyagé en Europe à ce moment-là. Ils ont travaillé à Paris, rencontré Cocteau, qui a monté la pièce très peu de temps après la mise en scène d’Elia Kazan à Broadway. La première traduction en français date de cette période.
Qu’est-ce qui vous a attiré dans cette écriture ?
L’écriture est assez brute, dans la recherche de l’émotion plutôt que d’un style. Il s’agit de chercher le côté trivial de l’humain, enlever le fard aux personnages. Tennessee Williams a fait un vrai travail d’orfèvre sur la langue parlée. Il ne s’est pas empêtré dans des effets de style. La langue est moderne, jeune, directe. Elle a une vraie fluidité. C’est un régal d’entendre les comédiens sur le plateau…
Ce n’est pas la première fois que vous collaborez avec le metteur en scène et comédien Valentin Rossier ?
Non, notre collaboration remonte à l’époque du théâtre du Garage, dans les années 1990. Elle s’est affirmée dans ma mise en scène du Funambule de Jean Genet en 2009. Mais il s’agit là d’une vraie collaboration. Nous avons choisi la distribution en commun. Marie Druc était déjà sa partenaire dans Qui a peur de Virginia Woolf ? de l’Américain Albee. Anna Pieri est aussi une comédienne avec qui il a l’habitude de travailler. De mon côté, j’ai fait jouer Boubacar Samb et Latifa Djerbi. Pour collaborer, il faut avoir une sensibilité commune, être d’avis qu’« on joue Mozart comme ça… » Nous travaillons de la même manière, dans le non-éclat, la retenue.

Blanche vient rompre la petite vie tranquille de sa sœur Stella et de son beau-frère Stanley en débarquant dans leur taudis de la Nouvelle-Orléans. Outre l’intrigue autour de la triangulation amoureuse, que dit la pièce en arrière-fond ?
Elle met en avant le côté épidermique des relations humaines. Il arrive qu’on rencontre quelqu’un qui nous rende fou. C’est le cas de Blanche et Stanley, qui n’ont pas d’échappatoire. Ils oscillent entre le désir, le dégoût, la répulsion. On se trouve dans un huis clos, où les personnages éprouvent une forme de déracinement. Ils sont flottants.
Comment est donc ce Stanley Kowalski incarné par Valentin Rossier ?
J’ai tout de suite pensé qu’il serait un Stanley différent de Brando. Il est davantage dans le registre de l’ironie, de la stratégie, de la violence sourde. Valentin Rossier amène une subtilité bienvenue au personnage. Et je suis reconnaissante à Marie Druc d’avoir accepté le rôle de Blanche. C’est une comédienne remarquable. Après la mise en scène d’Elia Kazan, puis son film, Vivien Leigh est restée habitée par le personnage pendant deux ans. Je demeure soufflée par le fait que c’est un homme qui a écrit le texte. Il avait une sœur dont il était très proche. Elle a fini dans un hôpital psychiatrique. La pièce porte en quelque sorte l’âme de sa sœur.
Au fond, qu’est-ce qu’incarne ce personnage de Blanche ?
La pièce traite du thème magnifique de la différence. Blanche Dubois est bannie, elle incarne la fêlure. Il lui faut assurer sa survie. C’est l’un des plus beaux rôles féminins de la littérature théâtrale américaine, comme il y en a aussi chez Tchekhov. En somme, nous sommes toutes des Blanche Dubois… Chez Tennessee Williams, les rôles de femmes sont d’une finesse impressionnante. Il a compris les tourments de l’être, ce qu’on voit bien aussi dans Chatte sur un toit brûlant. Il était lui-même très yin et yang. Williams a également réussi à injecter beaucoup de tendresse et d’ironie dans le personnage de Stanley Kowalski qui joue la brute. La pièce est si bien écrite qu’on ne sait jamais qui de Blanche ou de Stanley est le personnage le plus fou…
Propos recueillis par Cécile Dalla Torre
Découvrez toute la saison du Théâtre de l’Orangerie sur leprogramme.ch ou sur le site du Théâtre www.theatreorangerie.ch
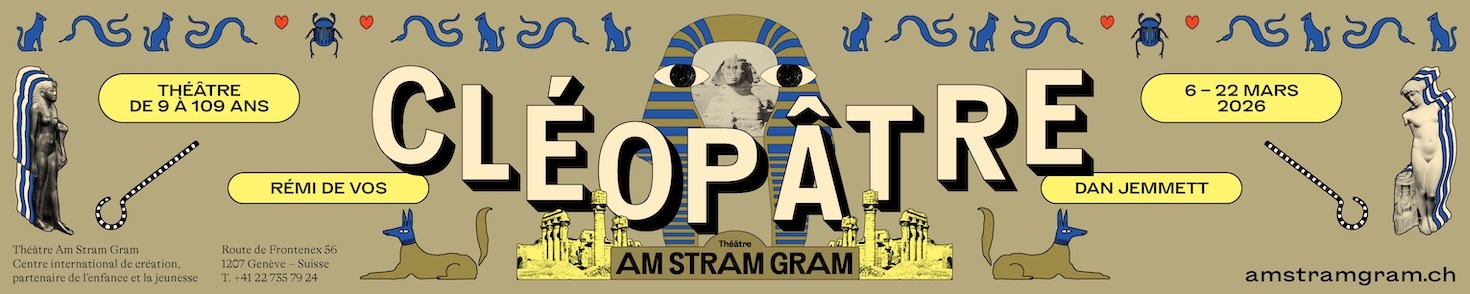


.gif)





